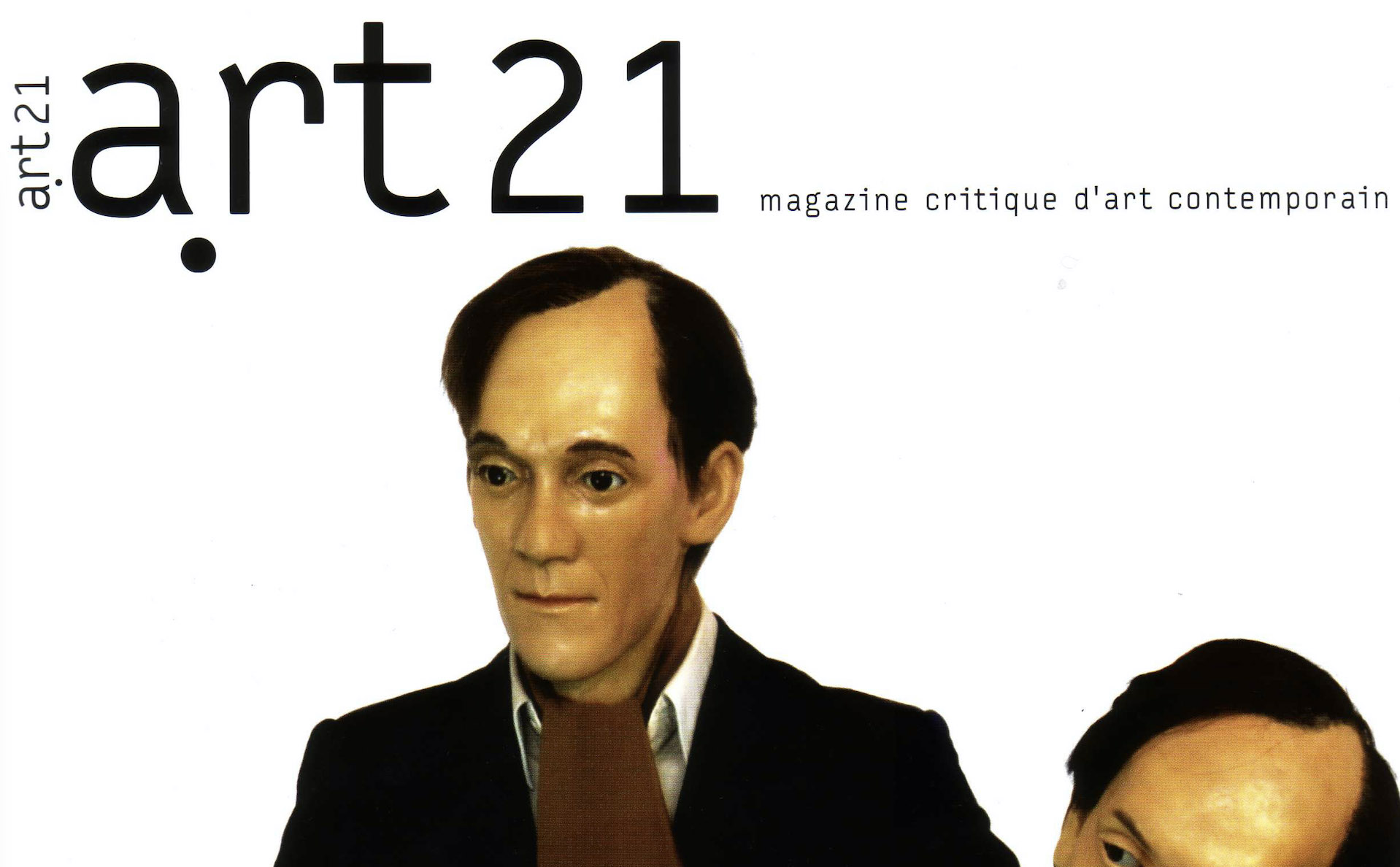
Des corps de style
par Rémy Argensson (Art 21)
Dans cette série intitulée Corps de style, datant de 2005, Julien Spiewak tente de concilier à la fois sa passion pour le meuble d’époque et ses recherches photographiques sur le corps. C’est à la suite d’une collaboration avec un collectionneur parisien, qu’il obtient le sésame pour pénétrer dans quelques appartements bourgeois de la capitale.
La sélection de ces photographies procède d’un choix précis qui vise à ne pas réduire cette série, en réalité plus ample, à une simple taxinomie homogène. Cet échantillon, sans pourtant être disparate, n’en demeure pas moins, et ce à bien des égards, relativement hétérogène. Dans ces conditions, il est intéressant de noter le rapport particulier qu’entretient le corps du modèle entre la légende et l’image photographique. Le corps, s’il est toujours fragmenté, fini par se dissimuler à la fois dans l’image et dans la légende. Des corps dans le décor. Dissimulation soulignée par le fait de conserver l’intégralité de la légende dans le corps même du texte[1].
Le corps du modèle n’est jamais placé par rapport à l’usage préconçu du meuble qui l’accueille, mais se dispose de manière à interroger tout usage préexistant. Dès lors, au lieu de chercher à rendre « la » fonction propre au meuble. Le corps face au meuble se construit lui-même comme modèle en détournant l’usage imposé. Ainsi le corps vient se surajouter au meuble sans pour autant révéler une fonction précise. C’est exactement ce que nous montre Aude. Bergère à oreilles en bois doré mouluré, frise de rubans, style Louis XVI (p.1), où le corps est étroitement lié au meuble. Le dos et les fesses du modèle s’emboîtent parfaitement dans la courbure du dossier de la bergère. Ce qui n’est pas sans évoquer le travail de Valie Export dans les années 1960-70. Cette artiste autrichienne, par ces actions et autres performances, entendait s’affranchir tant du puritanisme de la société viennoise de l’époque qu’avec le machisme des actionnistes viennois[2]. Son art féministe, s’il en est, quand bien même met-il en oeuvre le corps de l’artiste ne s’apparente ni avec le happening ni avec le Body Art, mais avec la communication médiatique. En fait, elle cherchait à utiliser les stratégies de la communication et de la publicité à ses propres fins pour dénoncer à la fois la manière avec laquelle les médias construisent habituellement l’image de la femme[3] et la place faite aux femmes dans la société. À cet égard dans ses Body Configurations son corps vient se surajouter à l’architecture de la ville dans des postures inattendues. Dans cette série, elle met en scène son corps successivement sur un banc en béton, s’allonge au pied d’un angle d’immeuble, s’enroule autour d’une colonne ou encore s’inscrit à l’intérieur d’une structure métallique d’un pont. Sans doute Abrundung (1976) est-elle l’image la plus caractéristique de cette série, où le corps justement de Valie Export épouse l’arrondi d’un rond-point. Tout son corps est étiré au maximum pour venir se plaquer contre les pierres du trottoir. De la même façon, ici, le corps est ce supplément, qui en cherchant à faire corps avec le meuble semble le compléter. Corps et mobilier sont en harmonie parfaite. Le sujet et l’objet comme par interaction imaginaire accusent d’ailleurs chacun à leur manière le passage du temps. Les irrégularités de la peau, boutons, rougeurs et autres vergetures répondent aux différentes traces d’usure du meuble, écailles de la dorure, patine des clous de tapissier et stries du velours.
Cependant le gros plan de la photographie, en décontextualisant le corps et le meuble, réduit — hélas — la photographie à un jeu formel de courbes. C’est la raison pour laquelle, dans la photographie de Carole. Commode d’époque Louis XV. Paire d’embrasses de rideaux, en offrant un plan plus large, semble, de ce point de vue, plus pertinente. Le corps de Carole nue, sans pieds ni tête, étendue sur la commode se présente comme une barre de fraction séparant — en deux la photographie dans le sens de la longueur — le marbre ocre jaune de la commode du mur de couleur beige, dont il tend à prendre d’un côté comme de l’autre la teinte. Cette photographie peut s’appréhender comme le véritable pivot de la série autour duquel s’articule deux problématiques. Elle marque en effet le passage du corps accolé au corps dissimulé. Ici, ce corps allongé opère comme une transition entre les deux problématiques. Car, à partir de cette photographie, le corps ne se contente pas simplement d’épouser la forme du mobilier, mais cherche progressivement à disparaître dans le décor.
Tout comme le phasme qui, apparemment sans queue ni tête, ressemble à s’y méprendre à l’extension d’une branche sur laquelle il se pose, la dissimulation du corps du modèle dans la photographie Carole. Canapé d’époque Louis-Philippe est pratiquement complète. En effet, une vue un peu rapide de l’image ne permet pas de discerner le modèle, en l’occurrence Carole, du canapé. En dépit de l’homogénéité apparente du cliché, notre regard est quelque peu perturbé par un élément qui semble contrarier la construction de l’ensemble. Ce n’est qu’au moment où notre perception se fait plus précise que l’on entrevoit un petit fragment du corps, sans tête ni jambes, qui, comme l’animal, se fond dans le milieu où il vit. Le dos du modèle, dont on ne perçoit qu’un fragment, devient lui-même un coussin parmi d’autres posé sur le canapé. Le corps morcelé se dissimule dans le décor à la manière de l’« insecte-brindille » qui, selon Georges Didi-Huberman, « fait de son propre corps le décor où il se cache[4] ».
Ce qui, dans le registre de l’idiotie, théorisé par Joannais[5], peut faire penser à la série de l’artiste Saverio Lucariello dénommée précisément L’infiltré [The Infiltrator] (1995-2000) dans laquelle, avec un peu d’attention nous finissons par comprendre que chaque photographie est infiltrée dans son bord par le bout d’une verge[6]. Un excédent qui, placé en rapport ou dans l’indifférence avec le sujet représenté, interroge toujours le spectateur sur la nature de ce bout de chair informe venant parasiter les images.
C’est également en ces termes que Salvador Dali évoque la photographie comme modèle de la peinture surréaliste, dans la mesure où elle peut introduire ce trouble dans la peinture[7]. En 1937, dans un article de la revue Minotaure, Dali nous fait la description d’une photographie anonyme représentant deux femmes et un homme devant une porte d’entrée, et dont les regards convergent tous vers l’objectif du photographe[8]. Apparemment, le sujet central de la photographie — ces trois personnages — posent sous l’autorité et la maîtrise du photographe. Cependant Dali nous invite à dépasser la psychologie des individus représentés, en particulier celui de l’homme plongé dans l’obscurité. Car ce qui intéresse davantage Dali dans cette photographie, c’est un petit détail hétérogène, qui figure dans l’angle inférieur gauche de la photographie : une petite bobine sans fil. Un objet qui, à l’encontre malgré tout du corps de Carole sur le canapé ou des infiltrations de Lucariello, sous son aspect anodin, vient démentir la maîtrise totale de la mise en scène. En échappant aux mains expertes du photographe, la bobine sans fil affirme l’aspect excédentaire, le « trop à voir » de la photographie.
Cette logique du double regard s’avère encore plus probante dans la photographie intitulée Aude. Large canapé garni de velours jaune, travail du XVIIIe siècle. Secrétaire d’époque Louis XVI. Table de salon de style Louis XV. Paire de fauteuils cabriolets garnis de tapisserie au point à fonds rouge d’époque Louis XV. Tapis d’Orient en laine à fonds bleu et bordeaux (p. 4). La lumière plus claire qui inonde ce salon de style, provoque également un découpage d’ombres très contrasté : celle du secrétaire, des deux lampes et des fauteuils se projetent sur le dossier du canapé, le mur blanc et le sol beige. De surcroît, les plis discrets du tapis, ainsi que le léger décentrement de l’abat-jour sont autant de micro détails de la photographie qui contribuent à instaurer un climat étrange. Une inquiétude semblable à celle repérer par Walter Benjamin qui, dans L’œuvre d’art à l’ère de reproductibilité technique, comparait les rues désertes de Paris au début du XXe siècle, photographiées par Atget, à des lieux du crime[9] qui « inquiètent celui qui les regarde[10] ». Alors même si cette photographie ne possède pas l’efficacité documentaire, devant une telle scène (du crime ?) notre regard fini également par hésiter. Soupçon d’ailleurs redoublé lorsque nous finissons par apercevoir ce fragment de corps (bras ou jambe ?) qui gît sous le canapé. La découpe franche des extrémités associé à une couleur et une matière uniforme n’est pas pour rassurer le spectateur. Nous serions alors tenté par un Blow Up, comme David Hemmings le héros du film éponyme d’Antonioni. Car, à y regarder de plus près, la nature de ce fragment devient suspecte : appartient-il réellement à un corps humain ou n’est-il qu’un simulacre en plastique ? Toutefois gardons-nous d’une interprétation trop rapide, qui viendrait qualifier ce trouble d’Unheimlich, comme Jentsch dans sa lecture du conte d’Hoffmann L’homme au sable. À propos duquel, il soutient qu’abandonner le lecteur à l’indécision quant à la nature véritable d’Olympia — s’agit-il d’une personne ou d’un automate ? — est ce qui provoquerait l’effet d’Unheimlich. Or, Freud insiste sur ce point avec vigueur, en soutenant que l’enjeu n’est pas du tout de savoir si Olympia est vivante ou inanimée. L’incertitude intellectuelle, que provoque en nous cette photographie, n’est pas une condition suffisante pour engendrer l’inquiétante familiarité[11].
Dans la photographie Carole. Commode d’époque Louis XV. Miroir de style Louis XV. Pendule d’époque Louis XVI. Paire de bougeoirs du début du XIXe siècle (p. 6), le bras du modèle se substitue à la seconde embrasse du rideau. Une situation incongrue que l’on rencontre souvent dans le théâtre de boulevard lorsque, par exemple, l’amant tente de se cacher à l’arrivée du mari légitime. Encore qu’ici, au lieu de chercher à disparaître complètement, le corps, dans une surenchère mimétique, se transforme lui-même en accessoire du décor, et retrouve une fonction utilitaire. L’objectivation du corps ne signifie pas pour autant sa défonctionalisation, mais lui octroie une autre fonction, celle de tenir replié un rideau ou de remplacé un accoudoir comme dans Aude.Canapé garni de tapisserie à médaillons fleuris de style Louis XVI. Paire de fauteuils à dossier médaillé en cabriolet, garni de tapisserie à médaillons fleuris, estampillé J.B. Boulard, époque Louis XVI. Miroir d’époque Louis XV. Cette fois le détail corporel, le bras du modèle, en se tenant à la périphérie de la photographie, nous oblige à une attention plus soutenue. Sagit-il pour autant de « corps-objet[12] » au sens où l’entend Éric Madeleine, plus connu sous l’appellation Made in Eric[13], qui cherche à instrumentaliser son corps en devenant tour à tour pied de table, balançoire, cendrier… Rien n’est moins sûr, puisque d’une part, même s’il partage la nudité, le corps de Made in Eric n’est jamais fragmenté, et d’autre part il ne remplace pas seulement une partie mais souvent l’objet lui-même (oreiller, chaise, charrue, sous-vêtement). Dans Sans titre (p. 8), Cette photographie, qui ne porte ni de prénom ni de description de mobilier, opère en même temps un changement de décor. Elle nous fait pénétrer dans une partie de l’appartement bourgeois habituellement caché au public : l’envers du décor. Et pour cause, ici le style ostentatoire fait place au standard, la grande diffusion se substitue à l’estampille de maître. L’intérieur d’un dressing où sont soigneusement rangés cravates, chemisiers et autres couvertures. Mais une fois de plus, notre regard est attiré par un bras qui, derrière un meuble blanc à tiroirs, prend l’apparence d’un vêtement posé sur un cintre aligné au milieu des housses protectrices de la penderie.
Enfin, devant l’ Autoportrait. Table d’époque Napoléon III. Repose pieds d’époque Louis-Philippe (p. 2), le spectateur, fort de l’expérience passée, s’empresse de scruter la photographie pour découvrir un fragment corporel de l’auteur… Sauf qu’ici, le photographe tend un piège aux regards trop systématiques qui se laisse porter par l’application d’une règle invariable. Tout au plus peut-on y voir en négatif les célèbres apparitions en cameo[14] d’Alfred Hitchcock dans ses films. Ces apparitions furtives étaient un jeu pour le réalisateur, tout en palliant au manque de figurants elles devinrent toutefois très vite une obligation car ces clins d’œil anecdotiques adressés aux initiés étaient guettées par l’ensemble de ses fans. Dans ces conditions, craignant que les spectateurs ne soient détournés de l’intrigue, Hitchcock désamorça l’enthousiasme naissant en apparaissant dès les premières minutes du film. Or, ici, ni intrigue, ni apparition de l’auteur. Aussi est-il vain de vouloir déceler la moindre partie humaine dans cette image. À la différence des Selfportraits de Lee Friedlander, il n’y a même pas l’ombre d’un quelconque autoportrait. L’aspect déceptif de cette photographie à néanmoins le mérite de venir contrarier à la fois la série et notre regard habitude, en tournant en dérision le genre autoportrait. Même si le défaut de présence humaine ajouté au plan rapproché force rapidement notre regard à se replier sur le caractère formel de la photographie. Ainsi la ligne brisée que dessine le repose pieds en forme de V semble se transformer en un large sourire en guise de pied de nez au regardeur.
Rémy Argensson
Texte publié dans Art 21
[1] Ainsi les légendes des photographies viendront, par ordre d’apparition dans le texte même.
[2] Cf. Juan Vicente Aliaga, « La vie est entre vos mains. Questions de genre, féminisme et violence dans l’œuvre de Valie Export », Valie Export, Montreuil, Éditions de l’œil, 2003, p. 82.
[3] Notons que le nom de Valie Export est lui-même un pseudo construit dans l’idée d’une identité comme marque. C’est-à-dire qu’au lieu de chercher à lutter contre la marchandisation de l’art, l’artiste se considère elle-même comme un produit. Ainsi en 1968, elle abandonne le patronyme de son père, puis celui de son époux au profit d’une marque de cigarette autrichienne « Smart Export », Valie étant une abréviation de son véritable nom. Cf. Régis Michel, « Je suis une femme. Trois essais sur la parodie de la sexualité », Op. cit., p. 35.
[4] Georges Didi-Huberman, Phasmes. Essais sur l’apparition, Paris, Minuit, 1998, p. 17.
[5] Jean-Yves Jouannais, L’Idiotie. Art, vie, politique-méthode, Paris, Beaux-arts Magazine, 2003.
[6] Concernant cette série voir le catalogue de l’exposition Saverio Lucariello, Marseille, Images En Manœuvres Éditions, 2000.
[7] Nous pouvons d’ailleurs regretter qu’une telle conception de la photographie n’eut pas trouvé d’écho dans la peinture. Pour autant ceci donne une raison supplémentaire de rejoindre Rosalind Krauss qui, pour d’autres raisons, valorise la photographie au détriment de la peinture surréaliste. Cf. Rosalind Krauss, « La photographie au service du surréalisme », Explosante-fixe. Photographie et surréalisme, Paris, Hazan, 2002, p. 15, 19.
[8] Salvador Dali, « Psychologie non-euclidienne d’une photographie », Minotaure, n°7, 1937, p. 56-57.
[9] Walter Benjamin, « L’oeuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » (1935), trad. fr., Oeuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 82.
[10] Ibid.
[11] Freud, Sigmund, « Das Unheimliche » (1919), trad. fr., L’Inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985, p. 224, 229-230.
[12] Cf. Made in Éric, « Le corps-objet, ou la victoire de la pensée », entretien avec Laurent Goumarre (1997), Quasimodo, n°5, Montpellier, printemps 1998, p. 109-110.
[13] Il convient de souligner l’accointance que partage Made in Éric et Valie Export dans leurs constructions d’identité à travers leurs noms d’artiste respectifs.
[14] Ce terme est en fait une francisation de Cameo Appaerance qui prend naissance dans le milieu du théâtre anglo-saxon autour de 1851. Cf. Yves Calméjane, Histoire de moi. Histoire des autoportraits, Paris, Thalia Éditions, 2006, p. 92.





