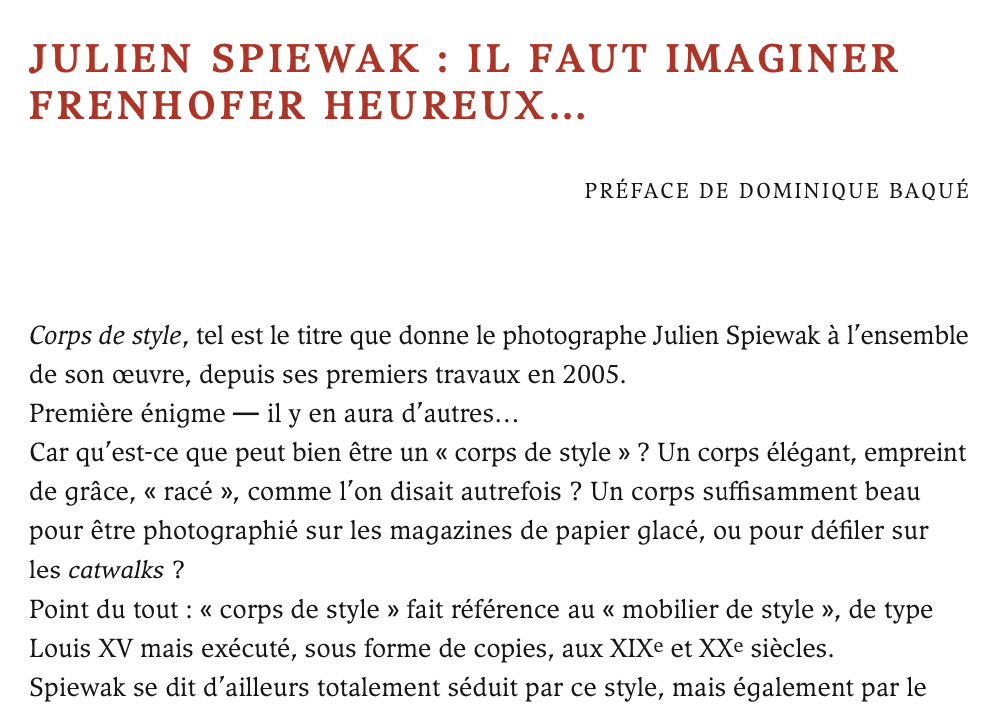
Julien Spiewak : il faut imaginer Frenhofer heureux…
par Dominique Baqué
Corps de style, tel est le titre que donne le photographe Julien Spiewak à l’ensemble de son œuvre, depuis ses premiers travaux en 2005.
Première énigme – il y en aura d’autres…
Car qu’est-ce que peut bien être un « corps de style » ? Un corps élégant, empreint de grâce, « racé », comme l’on disait autrefois ? Un corps suffisamment beau pour être photographié sur les magazines de papier glacé, ou pour défiler sur les catwalks ?
Point du tout : « corps de style » fait référence au « mobilier de style », de type Louis XV mais exécuté, sous forme de copies, aux XIXème et XXème siècles.
Spiewak se dit d’ailleurs totalement séduit par ce style, et il est étonnant que l’appartement de ce jeune homme soit lui aussi meublé de cette façon, avec un grand raffinement et une certaine préciosité assumée – là où les trentenaires sont supposés préférer les lofts avec architecture industrielle et mobilier design. Comme s’il y avait une profonde et intime cohérence entre l’œuvre du photographe et son mode de vie. « Intempestif », au sens nietzschéen du terme, cet artiste ?
Spiewak a commencé sa quête photographique chez des particuliers, examinant avec attention leur mobilier, leurs effets personnels, l’agencement des pièces, tant un intérieur dit quelque chose de celui qui y vit, tel un portrait indirect. Chaque objet y est le dépositaire d’une histoire, d’une mémoire, et nul hasard donc à ce que les propriétaires de ces appartements soient la plupart du temps âgés : eux aussi ont une longue histoire, une mémoire chargée, et ils se plaisent à raconter.
Les premiers essais photographiques montrent leurs corps et leurs visages, vêtus bien évidemment, au cœur de ce « mobilier de style » : mais, très vite, les photographies encourent le risque de « faire magazine », du type Marie-Claire Décoration, ou Gazette Drouot. Les images sont trop sages, trop convenues.
D’où le tournant pris par l’artiste : il s’agit tout à la fois de dépersonnaliser, d’introduire une part de mystère, et de subvertir la convention de ces premières photographies en introduisant, à l’intérieur même de ces appartements quelque peu rigides et compassés, des corps nus. Ou, plus exactement, des fragments de corps nus.
Il peut y avoir une certaine violence dans la fragmentation d’un corps : on peut l’imaginer abîmé, coupé, découpé, voire tranché, mutilé. Or, ici, il n’en est rien : les fragments de corps sont toujours d’une infinie douceur et, quoiqu’imparfaits parfois, ils épousent avec grâce la courbe d’un sofa, d’un manteau de cheminée ou d’un escalier, ou bien encore font écho à la tessiture d’une tenture, aux veines d’un marbre.
Car ici les corps ne sont pas systématiquement parfaits : un œil attentif découvre souvent sur leur peau quelques taches superflues, des grains de beauté, des plissements et des rides, la marque disgracieuse laissée par une culotte ou un soutien-gorge.
Modus operandi de Spiewak : l’artiste travaille toujours in situ, en appelle à des amis modèles, ne retouche jamais ses images et abhorre Photoshop. Les prises de vue sont systématiquement frontales, face aux œuvres. Jamais de vues en biais, jamais de plongées ou de contre-plongées – ces procédés dits modernistes qu’affectionnaient particulièrement les photographes avant-gardistes de l’entre-deux-guerres.
Car la référence de Spiewak est double : le documentaire, et l’École de Düsseldorf. Son admiration va aux Becher, Thomas Ruff, Thomas Struth et Andreas Gursky. Mais aussi au travail de Candida Höfer – je pense ici à ses Bibliothèques –, au Versailles de Robert Polidori, et, plus étonnamment, à celui de Thomas Demand, quand bien même ce dernier travaille à partir de maquettes. James Casebere, aussi.
Mais la référence ultime demeure peut-être Atget, dont on connaît l’immense documentation du vieux Paris, un peu moins, sans doute, ses intérieurs parisiens, et, aux dires de Spiewak, ses photographies prises à l’intérieur de l’ambassade d’Autriche. D’ailleurs, l’un des projets de Spiewak pour l’avenir est de retourner à l’endroit exact de ces intérieurs pour les rephotographier et y introduire, à son tour, des corps nus.
Puis, du décor intime des particuliers, l’artiste est progressivement passé à l’espace public du musée : mais les musées choisis par l’artiste ont toujours pour particularité d’avoir été des lieux d’Histoire, certes, mais aussi de vie.
Ainsi, en France, le musée de la Chasse et de la Nature, le musée de la Vie romantique, le musée Cognacq-Jay. En Hollande, le museum Van Loon ; en Italie, deux palais des Doria Pamphilij, une grande famille qui a profondément marqué l’histoire de l’Italie, soit le palais Doria Pamphilij à Rome et la villa del Principe à Gênes. Au Brésil, la série Corps de style a également été réalisée dans trois lieux symboliques pour l’histoire du pays : le musée impérial, résidence de Pedro II – le musée de la République, ancien palais des présidents brésiliens – le palais Rio Negro, ancienne résidence d’été des présidents. À travers ces trois lieux emblématiques, se donne ainsi à lire une partie de l’histoire du Brésil, de l’Empire à la République.
Spiewak procède toujours de la même façon : le jour d’ouverture des musées, il opère un repérage minutieux des lieux, du mobilier et de leur agencement, en noir et blanc. Puis, dans le lignage d’un certain classicisme autrefois lié aux Beaux-Arts, il dessine une série de croquis préparatoires, afin de définir les cadrages et le futur emplacement des corps. Au plus loin de la photographie instantanée et du mythe forgé par Henri Cartier-Bresson de « l’instant décisif », Spiewak prévisualise tout, contrôle tout, maîtrise tout. Il y va d’une méthodologie extrêmement rigoureuse qui, de fait, le rapproche des protocoles affirmés par l’École de Düsseldorf.
Puis, de nuit, lorsque les musées sont fermés au public, l’artiste, qui a donc tout prévisualisé et qui est muni de ses croquis préparatoires, peut enfin introduire ses modèles et les insérer, de façon subreptice, surprenante, ludique parfois, au sein des salles et en écho au mobilier : un meuble, un corps.
Les photographies ainsi exécutées sont en numérique HD, puis tirées en argentique. Les tirages ne dépassent jamais les formats 50 x 70, ou 70 x 100, de façon à ce que les corps demeurent à l’échelle 1, pour ne pas devenir gigantesques, voire monstrueux.
Certes, Spiewak rêverait de travailler à la chambre mais, d’une part, cette pratique requiert une équipe assez importante et un temps long, tandis que la photographie numérique s’avère plus souple, et plus susceptible de capter rapidement la présence contrôlée des corps. Peut-être évite-t-elle aussi une certaine emphase, celle des formats de la peinture d’Histoire, par exemple, à laquelle l’artiste se refuse, préservant ainsi quelque chose de l’intime.
J’ai dit l’admiration que Spiewak porte à la Straight Photography et à l’École des Becher. Pour autant, l’extrême sobriété, voire l’austérité froide de ces « icônes » photographiques se voit chez Spiewak détournée et adoucie d’une double façon, au moins : les corps nus et fragmentés induisent une grâce, une sensualité, parfois même un érotisme subreptice parfaitement absents chez les Allemands ; et l’imprégnation culturelle et historique des images font signe vers un autre lignage photographique : ce que j’ai appelé, ailleurs, « les scénographies de la culture ».
Pour le dire ici plus brièvement, après le modèle dominant de l’École de Düsseldorf, les tropes du banal et de l’intime ont dominé la représentation dans les années 90, au point d’en devenir les topoï, voire même de se figer en doxa de l’époque.
C’est contre une telle hégémonie qu’un contre-courant s’est manifesté : de façon minoritaire, certes, mais avec une ambition théorique et plastique certaine. Une volonté claire d’opposer à l’affaissement de la forme, au rétrécissement de la perception et à la forclusion du monde la parfaite maîtrise de la forme, jointe à une non moindre parfaite maîtrise de la technique – sans pour autant verser dans le « technicisme »- le dialogue avec l’Histoire et la prise en compte des référents majeurs de la culture occidentale.
Du même coup, ces photographies que j’appellerai « érudites » – au sens où la pittura colta a pu connaître une renaissance dans les années 80 en Italie – requièrent une scénographie méticuleuse, une théâtralisation du geste, des postures et du décor qui se situent à rebours des images « hasardeuses ». Et si elles dialoguent volontiers avec l’histoire des formes, notamment avec la peinture, ainsi qu’avec la littérature occidentale, jusque dans ses fondements grecs et latins, elles tendent aussi à restaurer une esthétique de la beauté pourtant devenue caduque, frappée d’obsolescence par les avant-gardes historiques, et souvent traitée avec mépris par la jeune génération plasticienne.
Or, nul doute, les Corps de style de Spiewak sont érudits, cultivés, empreints d’Histoire et, sans péjoration aucune, ils s’inscrivent dans une recherche de la beauté.
La figure tutélaire de cette photographie érudite et qui fait la part belle à la mise en scène est incontestablement Karen Knorr : marquée par le documentarisme anglais dont elle a ensuite su se déprendre, nourrie de la pensée structuraliste et notamment influencée par Victor Burgin, Knorr a longtemps pratiqué une photographie en noir et blanc, hiératique et glacée, systématiquement doublée par un texte et impliquant une référence simultanée à l’espace de la page imprimée et à la séquence cinématographique, comme dans la série Belgravia (1979-1981). C’est à partir de Connoisseurs (1986-1988) que la référence au documentaire s’est vue peu à peu écartée, tandis qu’est apparue la couleur et que le texte, certes toujours présent, s’est fait légende, plaque muséale. Conjointement, c’est vers la peinture et plus spécifiquement la peinture du XVIIIème siècle que l’œuvre photographique fait maintenant signe.
Pour bref rappel : Académies (2001), Sanctuary and Spirits (2001) se succèdent, jusqu’à cette utilisation, aujourd’hui, de Photoshop pour inscrire des animaux dans ses images – ce que récuse, je l’ai dit, Spiewak.
Dans cette lignée de la photographie érudite et mise en scène, je pourrais également citer l’Anglo-Suisse Olivier Richon, la Française Dany Leriche ou encore l’Anglaise Sam Taylor-Wood. Et, bien évidemment, le Canadien Jeff Wall.
Tout autant donc, que de la Straight Photography et de l’École de Düsseldorf, c’est dans le lignage de ce courant si singulier et redevable de la high culture que je me proposerai d’inscrire aussi l’œuvre de Spiewak.
Et ce, d’autant que les photographies de l’artiste incluent toujours du texte : de façon oblique, parfois même invisible à un regard peu attentif, avec les numéros des salles de chaque musée, et de façon beaucoup plus affirmée, selon une méthodologie extrêmement précise, presque maniaque, avec la légende des meubles et tableaux, incluant toujours, tel un clin d’œil ludique, le prénom du modèle.
Dominique Baqué
Extrait de la préface du livre « Julien Spiewak – Le Chef-d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac », ed. Espace_L, 136p. 2021.





